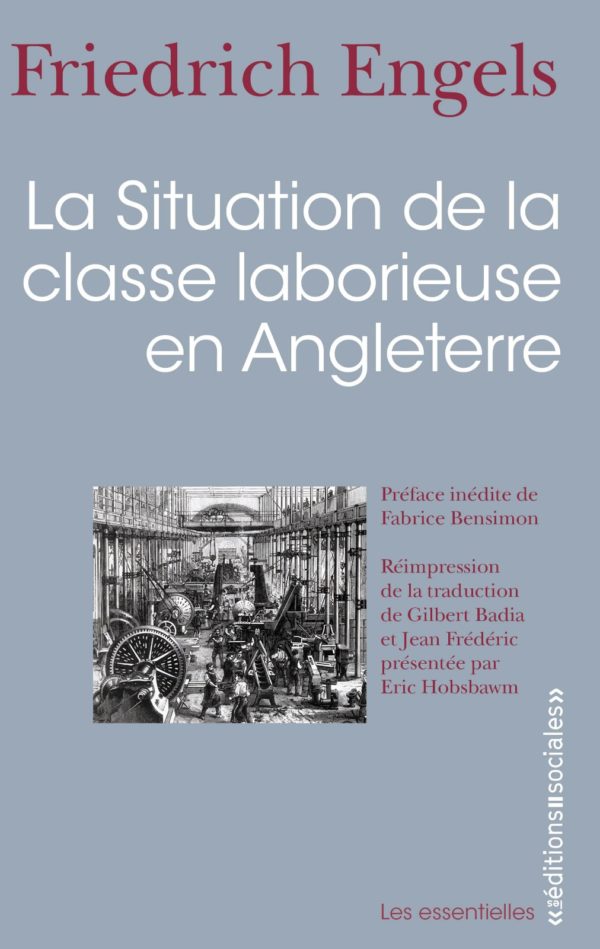La Situation de la classe laborieuse en Angleterre (1845) par Friedrich Engels
Joakim Martins •
Die Lage der arbeitenden Klasse in England paraît initialement en allemand à Leipzig en 1845. C’est le tout premier ouvrage d’un jeune Allemand de vingt-cinq ans, Friedrich Engels (1820-1895), qui n’est encore à cette époque ni un proche de Karl Marx ni une figure du mouvement ouvrier européen. Engels, fils d’un florissant industriel actif dans le textile, s’expatrie en 1842 à Manchester d’un commun accord avec son père, afin de travailler dans une entreprise à laquelle ce dernier est associé. Le pater espère ainsi éloigner son héritier de ses engagements politiques en Allemagne, quand celui-ci escompte se rapprocher de l’épicentre du capitalisme et du prolétariat organisé anglais. La première œuvre, constituée à partir de lectures de journaux et de documents en tout genre ainsi que d’observations participantes, du futur co-auteur du Capital est le fruit de ce séjour de vingt et un mois.
La ville de Manchester, dont traite en particulier La Situation de la classe laborieuse en Angleterre, est la première véritable cité industrielle au monde. La localité, qui est alors connue sous le sobriquet de Cottonopolis, a vu tripler sa population entre 1801 et 1841 pour atteindre 242’000 habitant·e·s et un cinquième de cette dernière est désormais employé dans l’industrie cotonnière. En plus d’être considérée comme la capitale industrielle de la planète, Manchester a aussi abrité les premiers embryons d’organisations ouvrières et vu s’enchaîner — lors du premier XIXe siècle — grèves, émeutes et mobilisations prolétariennes. C’est également dans les environs mancuniens que les chartistes[1] auraient réussi en 1838 à réunir, lors d’un rassemblement public, 200’000 personnes.
Dans les années 1840, la question sociale est au cœur de toutes les discussions politiques au Royaume-Uni et de très nombreux rapports sur les conditions d’existence des travailleuses·eurs sont alors publiés. La Situation diffère toutefois radicalement de ceux-ci. En plus de décrire la misère ouvrière, cet «acte d’accusation contre la bourgeoisie anglaise» met également en avant les luttes émancipatrices de la classe laborieuse contre celle-ci. Friedrich Engels ne visite pas non plus les quartiers prolétaires et n’interroge par leurs occupant·e·s, comme il est de coutume chez les enquêtrices·eurs sociales·aux de son époque, accompagné des autorités locales ou de la police. En revanche, il accède aux mondes populaires par l’intermédiaire de Mary Burns — une manœuvre irlandaise qui deviendra sa compagne — et de plusieurs militant·e·s chartistes. Dans sa préface, le jeune révolutionnaire indique avoir avant tout tracé le portait de la condition prolétarienne anglaise afin que le lectorat allemand soit au courant de ce qui attend dans quelques années sa propre classe ouvrière.
Ce texte plus qu’engagé n’est traduit pour la première fois en langue française qu’en 1933, soit près de nonante ans après la sortie germanophone du livre, et près de quarante ans après le trépas de son auteur. Pour ma part, j’ai eu recours à la récente republication[2] aux éditions sociales de la parution francophone de 1961 réalisée par Gilbert Badia et Jean Frédéric, et préfacé par le célèbre historien marxiste britannique Eric Hobsbawm. Comme l’intitulé du présent compte rendu le laisse deviner, j’ai choisi comme fil rouge de celui-ci le temps écoulé entre l’écriture et ma lecture de La Situation. Mon idée est avant tout de présenter comment ont vieillis dans la tradition philosophique d’Engels les concepts présentés dans sa toute première parution.
La naissance de la classe ouvrière
Dans le chapitre introductif de son ouvrage, Friedrich Engels retrace longuement l’histoire de l’émergence de la classe laborieuse en Angleterre. Selon ce récit, le prolétariat naît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en raison de la révolution industrielle ainsi que de l’invention de la machine à vapeur et de celle à travailler le coton.
Avant ces importantes innovations, le travail cotonnier est quasi exclusivement effectué à domicile en zone rurale. La·le tisserand·e, qui travaille bien moins que huit ou douze heures par jour, est alors seul·e maître·sse de sa production. Étant correctement rémunéré·e, elle·il peut se permettre d’acquérir une parcelle de terrain qu’elle·il cultive durant son temps libre. Alors que leurs conditions de vie étaient tout à fait soutenables, les premiers dispositifs mécaniques transformant le coton forcent alors les tisserand·es à se concentrer uniquement sur leurs activités textiles et à céder leurs propriétés agricoles. Elles·ils deviennent à ce moment-là des prolétaires[3]. Les très nombreux terrains mis en vente sont ensuite acquis par une minorité de propriétaires terrien·ne·s, ce qui engendre à son tour la formation d’une nouvelle classe de grand·e·s fermières·ers. Disposant désormais d’énormes domaines, les coûts de production de ces dernières·iers chutent par conséquent drastiquement. Quantité de petit·e·s travailleuses·eurs de la terre ne peuvent dès lors plus être concurrentiel·le·s et doivent se résoudre à se séparer de leurs terres et devenir elles·eux aussi des prolétaires.
Cette prolétarisation en masse est responsable de profonds bouleversements socio-économiques. Si au début du XVIIe siècle, l’Angleterre est un pays très largement rural et sans industries, Londres est — au moment de la rédaction de l’ouvrage, soit en 1845 — d’ores et déjà une métropole peuplée par deux millions et demi de personnes et deux tiers de la population anglaise travaille dans l’industrie. Friedrich Engels souligne par ailleurs l’importance de ces profondes transformations en filant la comparaison suivante: «La révolution industrielle anglaise a, pour l’Angleterre, la signification qu’a pour la France la révolution politique [de 1789] […] et l’écart existant entre l’Angleterre de 1760 et celle de 1840 est au moins aussi grand que celui qui sépare la France de l’ancien régime de celle de la révolution de Juillet».
Ce processus de naissance de la classe ouvrière diverge grandement de celui qui sera plus tard proposé en 1867 par Karl Marx. Dans le livre I du Capital[4], l’invention de la machine à vapeur, le déclenchement de la révolution industrielle, tout comme l’avènement du prolétariat sont envisagés comme étant des résultantes à long terme des enclosures[5].
En outre, sa description des populations rurales préindustrielles est pour le moins sujet à fortes controverses. Engels avance effectivement à maintes reprises qu’elles «ne faisaient pas de politique, ne conspiraient pas, ne pensaient pas […] et se sentaient à l’aise dans leur paisible existence végétative». Ainsi, toute agentivité politique leur est tout simplement déniée. Il est néanmoins possible d’estimer que le futur compagnon de route de Marx reviendra en 1850 sur cette description en rédigeant La Guerre des paysans en Allemagne[6], dans laquelle il prendra fait et cause pour une révolte campagnarde s’étant déroulée en 1525 dans différentes régions du Saint Empire romain germanique.
La structuration des villes industrielles
En plus de fournir une explication à la genèse de la classe travailleuse, La Situation de la classe ouvrière en Angleterre s’évertue à rendre aussi compte avec précision des répercussions urbaines de la prolétarisation des masses rurales. Toute une section de l’ouvrage est dédiée à la description des nouvelles cités industrielles que compte dorénavant la Grande-Bretagne. Engels y brosse notamment un tableau particulièrement fin de l’organisation socio-spatiale de l’agglomération mancunienne — qu’il connaît particulièrement bien étant donné qu’il y a vécu pendant quasiment deux ans.
Il est, selon le natif de Barmen, tout à fait possible «[d’] habiter [Manchester] des années, [d’]en sortir et [d’]y entrer quotidiennement sans jamais entrevoir un quartier ouvrier ni même rencontrer d’ouvriers, si l’on se borne à vaquer à ses affaires ou à se promener». Il éclaircit par la suite ce constat en mettant au jour la stricte ségrégation régnant à Cottonopolis entre les quartiers ouvriers et ceux propres à la classe possédante. Dans un premier temps, il décrit son centre-ville comme étant un grand secteur commercial n’abritant que des boutiques et des dépôts. Personne ou presque n’y réside et la nuit seule la police circule en son sein. Le reste de Manchester est, par la suite, dépeint comme étant une gigantesque cité prolétarienne encerclant ce cœur commercial. Finalement, Engels avance que c’est en périphérie, au-delà des faubourgs prolétaires, qu’habitent les classes supérieures — quand la moyenne bourgeoisie occupe les arrondissements en contact avec ceux des travailleuses·eurs, la haute bourgeoisie possède des villas en campagne. Il fait également remarquer que les seules banlieues extérieures dans lesquelles aucun·e capitaliste n’est installé·e sont celles situées à l’est et au nord-est de la commune. Ce, pour la simple raison, que le vent y répand continuellement toutes les fumées d’usine de la ville. «Et le plus beau, relève très ironiquement Friedrich Engels, c’est que ces aristocrates de la finance peuvent, en traversant tous les quartiers ouvriers par le plus court chemin, se rendre à leurs bureaux d’affaires au centre de la ville sans seulement remarquer qu’ils côtoient la plus sordide misère à leur droite et à leur gauche», les avenues de Manchester empruntées étant en effet «flanquées des deux côtés d’une rangée presque ininterrompue de magasins [en] mains de la petite et moyenne bourgeoisie.»
Cette sociologie urbaine d’avant l’heure dénote l’importance, qui est donnée dans tout le livre, à interpréter le réel par l’intermédiaire de faits et de phénomènes sociaux. La précédente analyse sociogéographique pourrait d’ailleurs toujours être mobilisée telle quelle aujourd’hui. Le centre financier de certaines villes américaines contemporaines est effectivement, lui aussi, encerclé par des quartiers paupérisés, qui sont eux-mêmes entourés par des suburbs abritant les classes moyennes et supérieures.
Engels et les ouvrières
L’une des principales avancées théoriques, selon Eric Hobsbawm, réalisées par le co-fondateur du marxisme dans sa publication initiale est d’avoir traité de la classe ouvrière dans toute sa diversité. Dans cette dernière, une fraction de la masse travailleuse est néanmoins particulièrement mise sur un piédestal: les ouvrières·ers d’usine, soit celles·ceux qui travaillent la laine, la soie, le lin ou le coton en ayant recours à la force hydraulique ou la vapeur. Cette catégorie est alors décrite comme étant «la plus nombreuse, la plus ancienne, la plus intelligente et la plus énergique; mais pour cette raison aussi la plus remuante et la plus haïe par la bourgeoisie». Bien que le terme ne soit pas encore usité — car conceptualisé bien plus tard par Lénine[7] —, les prolétaires d’usines forment en quelque sorte l’avant-garde du mouvement ouvrier.
Quelques pages plus loin, il est précisé que la majorité (52% exactement) de ces mêmes ouvrières·ers d’usine sont, en fait, des femmes. Il pourrait être par conséquent logiquement et légitimement attendu de la part de Friedrich Engels qu’il souligne le rôle décisif qu’ont à endosser les travailleuses au sein du prolétariat organisé ainsi que la nécessité de leur engagement contre le patronat. Bien au contraire… Il postule plutôt que «le travail des femmes […] désagrège complètement la famille » et remarque « [qu’]il va de soi qu’une fille qui a travaillé l’usine depuis l’âge de neuf ans n’a pas eu la possibilité de se familiariser avec les travaux domestiques». S’il s’en prend si véhémentement aux ouvrières d’usine, c’est que les employeurs les embauchent — en raison du fait que leurs rémunérations s’élèvent au tiers de celles des hommes — afin d’abaisser les salaires de tout le monde et donc d’augmenter leurs profits. Engels déplore en outre avec grand fracas les configurations familiales dans lesquelles «c’est la femme qui nourrit la famille, et l’homme qui reste à la maison, qui garde les enfants, balayent les pièces et fait la cuisine» et les assimilent à une «castration de fait».
Bien qu’il fasse à plusieurs reprises la lumière sur les maladies professionnelles ou les discriminations patronales touchant spécifiquement les femmes, Friedrich Engels déroule — lorsqu’il est question d’embauche féminine — tout un argumentaire profondément masculiniste. Quoiqu’il ne l’exprime jamais très franchement, sa seule proposition semble être d’interdire aux ouvrières de travailler en usine afin de garantir un emploi correctement rémunéré à leurs homologues masculins. Jamais les idées, comme cela pourrait aller de soi aujourd’hui, de meilleures intégrations des personnes de sexe féminin aux combats syndicaux ou luttes pour l’égalité salariale ne sont même qu’esquissées dans tout l’ouvrage. Engels reviendra toutefois partiellement sur ces thèses misogynes en 1884 en se prononçant dans L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État[8] en faveur de l’entrée des femmes dans l’industrie et de l’égalité juridique entre les sexes.
Grèves et mouvement ouvrier
Similairement aux très nombreux rapports sur la condition ouvrière dont elle est la contemporaine, un grand nombre des pages de La Situation est dédié à la déploration des terribles modalités de logement, de travail et de vie auxquelles font face les prolétaires du premier XIXe siècle. Cela dit, la spécificité du livre est d’également relater les luttes des principales·aux concerné·es contre ces fléaux.
Les premières révoltes prolétariennes contre l’exploitation capitaliste prennent la forme du crime, puis du luddisme — soit le fait de briser les machines avec lesquelles on travaille. Ces formes d’oppositions sont, toutefois selon Engels, globalement inefficaces, car individualisées. Une fois l’auteur·e de l’infraction désigné·e, l’ensemble de la collectivité se retourne contre elle·lui et réduit à néant ses efforts. Avec l’abrogation par le Parlement britannique en 1824 du Combination Act, la loi autorise dorénavant la fondation d’associations ouvrières. Les travailleuses·eurs découvrent par conséquent le combat collectif, qui est bien plus efficient. En quelques mois, une kyrielle de Trade unions (syndicats) sont constitué au quatre coins du royaume. Les raison d’être de ces nouvelles organisations sont de négocier collectivement avec les employeurs et de venir en aide aux chômeuses·eurs par l’intermédiaire d’une caisse de solidarité ou alors en leur prodiguant des conseils. Le modus operandi des associations ouvrières est d’envoyer aux patrons rémunérant ou traitant mal leurs employé·e·s une délégation leur remettant une pétition et d’ordonner, en cas d’échec des pourparlers, la cessation du travail. La réussite de ce mode de lutte est, cependant, fortement dépendante d’une forte syndicalisation de l’usine en question et de la non-intervention de casseuses·eurs de grève.
Si Friedrich Engels considère que les interruption de travail peuvent déboucher sur des succès locaux et qu’elles ont le mérite d’abolir temporairement la concurrence entre travailleuses·eurs, il estime qu’elles ne sont pas susceptibles de «changer les lois de l’économie» et ne peuvent rien contre «les grandes causes» telles que les crises économiques. Cette vision pessimiste du pouvoir transformateur des cessations de travail sera vertement critiquée par de nombreuses·eux auteur·e·s anarchistes, tel que Mikhaïl Bakounine dans Étatisme et anarchie[9] paru en 1873, qui voient dans la grève générale l’instrument idéale de rupture avec le capitalisme. Après la révolution russe de 1905 – qui fut en partie provoquée par un gigantesque débrayage collectif prolongé, Rosa Luxemburg[10] acclimate en 1906 le concept de grève général à la tradition marxiste.
Un chef-d’œuvre social
Bien que «la révolution [qui] doit obligatoirement venir» n’ait finalement pas encore eu lieu, le regard fin et acéré de Friedrich Engels sur la société de son temps vaut, à l’heure qu’il est, encore largement la peine d’être redécouvert. Ses minutieuses descriptions des conditions de travail et de logement des prolétaires du XIXe sont d’une valeur inestimables. Bien que Max Weber ou Georg Simmel ne soient pas encore nés au moment de la rédaction de La Situation de la classe laborieuse en Angleterre, c’est définitivement en sociologue qu’il arpente les usines et quartiers ouvriers de Manchester et qu’il en rend compte.
Si son récit de la naissance de la classe ouvrière et sa démonstration de l’organisation socio-spatiale de la grande ville du Lancashire impressionnent toujours aujourd’hui par leur pertinence et font de son livre un véritable chef-d’œuvre social, ses conceptions de la grève et surtout du rôle des femmes au sein du monde du travail comme du mouvement ouvrier sonnent désormais plus qu’archaïques. Si comme toute production intellectuelle, La Situation est écrite depuis un point de vue — celui en l’occurrence d’un homme bourgeois, elle «demeure, selon les mots d’Eric Hobsbawm, un ouvrage indispensable, et qui fait date dans le combat pour l’émancipation de l’humanité».
[1] Le chartisme est un mouvement politique ouvrier dont le principal horizon est la démocratisation de la Chambre des communes.
[2] Engels, Friedrich, La Situation de la classe laborieuse en Angleterre, Paris: Les éditions sociales.
[3] Par prolétaire doit être compris celle·celui qui ne vit qu’à travers les revenus de son travail et qui en est donc dépendant·e d’une activité salariée.
[4] Marx, Karl, Le Capital. Livre 1, Paris: Gallimard, 2008. En particulier, le chapitre XXVII intitulé: L’expropriation de la population campagnarde.
[5] Ce mouvement, qui s’est déroulé en Angleterre principalement aux XVIe et XVIIe siècles, marque le passage — à travers la clôture des champs — d’une économie agraire communautaire à une forme individualiste.
[6] Engels, Friedrich, La Guerre des paysans en Allemagne, Paris: Les éditions sociales, 2021.
[7] Lénine, Que faire ?, Paris: Science Marxiste, 2009.
[8] Engels, Friedrich, L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, Paris: Les Ballustres, 2020.
[9] Bakounine, Mikhaïl, Étatisme et anarchie, Antony: TOPS/H. Trinquier, 2005.
[10] Luxemburg, Rosa, Réforme sociale ou révolution ? Grève de masse, parti & syndicats, Paris: La Découverte, 2001.