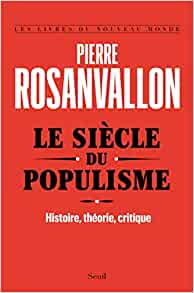Antoine Chollet •
Il arrive parfois d’avoir honte d’un membre de sa profession, ce qui n’est jamais très agréable. C’est la première impression que j’ai eue en lisant le dernier livre de Pierre Rosanvallon, Le siècle du populisme, confortablement publié dans sa propre collection aux éditions du Seuil (ce qui explique sans doute en partie sa nullité et les erreurs innombrables qu’on y trouve, l’ouvrage n’ayant été sérieusement relu par personne, visiblement1).
Comme la quasi-totalité des ouvrages traitant du populisme paraissant depuis maintenant une vingtaine d’années, l’avalanche grossissant d’ailleurs à vue d’œil sur les étals des librairies, celui-ci est, en réalité, une attaque contre la démocratie. À l’aide de sophismes en série, d’arguments emberlificotés, d’incohérences, d’ignorance et d’erreurs logiques, Rosanvallon cherche à attaquer par tous les moyens possibles les fondements des démocraties, à savoir le pouvoir du peuple, c’est-à-dire sa capacité à se gouverner et à se légiférer. Ce qui intéresse l’auteur n’est pas la démocratie en tant que principe ou que pratique, mais la gouvernabilité de nos sociétés, et il voit dès lors avec terreur la légitimité de leurs dirigeants et de certaines des institutions garantissant leur pouvoir s’effriter. Les quelques propositions qu’il avance en fin d’ouvrage n’ont donc pas pour objectif de démocratiser des régimes qui ne le sont pas suffisamment, mais d’assurer le maintien au pouvoir des personnes qui l’occupent déjà. Lorsque Rosanvallon propose de « démultiplier les modalités » de la représentation, par exemple en mettant en place des « dispositifs permanents de consultation » (p. 248), ou demande aux dirigeant·e·s de faire preuve d’« intégrité » (p. 251), on comprend aisément qu’il n’a aucune ambition de donner davantage de pouvoir aux citoyen·ne·s.
Il est une autre constante des éructations contre le populisme à laquelle l’ouvrage n’échappe pas : l’utilisation de ce que l’on reproche aux forces désignées comme telles. Dans le cas présent, cela prend la forme d’une stupéfiante ignorance des travaux scientifiques (de science politique, d’économie, de sociologie, d’histoire, etc.) produits depuis des décennies sur les phénomènes dont il parle. L’auteur de très loin le plus cité dans le livre est ainsi… Pierre Rosanvallon, qui nous offre paternellement un résumé de ses derniers livres comme preuve de ce qu’il avance dans celui-ci. Comme respect des règles minimales de la décence scientifique, on a fait mieux.
Le livre est tout entier construit autour du seul exemple de la France. Rosanvallon a d’ailleurs toujours fait preuve d’un extrême provincialisme, dès ses premiers travaux, et il ne connaît pas grand chose des recherches menées ailleurs, mis à part quelques rudiments très embryonnaires, notamment sur les États-Unis. L’exemple français illustre aussi une véritable « panique morale » chez l’auteur, qui se focalise sur la figure de Jean-Luc Mélenchon. Qu’on puisse (et doive) critiquer ce dernier, y compris et peut-être même d’abord d’un point de vue démocratique, c’est une évidence. Mais il faut aussi être capable de réfléchir posément à la question de la démocratie à l’écart de ce contre-exemple, ce que Rosanvallon a toutes les peines du monde à faire. Les citations d’extraits d’entretiens de Mélenchon parsèment ainsi son livre, sans aucune prise en compte des travaux qui ont été réalisés sur La France insoumise ou le Parti de gauche, et notamment ceux consacrés à leurs militant·e·s qui ne peuvent être identifiés au leader sans aucune nuance. Cette méconnaissance fait que l’on n’échappe pas à l’équivalence obligée avec le Rassemblement national et Marine Le Pen.
L’adversaire principal du livre est cependant ailleurs. Il s’agit du référendum, qui est attaqué dans un chapitre plus long et détaillé, mais pas moins fautif, que les autres. Ici aussi, le nombre d’imbécillités débitées en une vingtaine de pages est proprement stupéfiant. C’est comme si Rosanvallon n’avait rien lu, ou du moins rien entendu, ni sur la Suisse, ni sur les États-Unis2. Sa pensée véritablement tétanisée par le vote du Brexit, qui n’est précisément pas un exemple de référendum institutionnalisé, déclenché par des citoyen·ne·s et agissant comme un contre-pouvoir, Rosanvallon enfile tous les poncifs habituels contre la démocratie directe. Critique de l’irresponsabilité du peuple, du caractère binaire des questions posées lors des référendums, de l’absence de délibération préalable, et de la contrainte exercée par la règle majoritaire, l’auteur accumule les bévues sur le fonctionnement effectif des référendums, en Suisse et dans les États américains notamment, sans voir pourtant les vrais problèmes que leur usage pose parfois d’un point de vue démocratique. Pour Rosanvallon, le référendum devrait être limité à l’adoption des constitutions (avec des majorités qualifiées) et aux enjeux locaux. Or c’est précisément entre ces deux usages, certes importants, c’est-à-dire dans le domaine de la législation ordinaire et au niveau national, que le référendum permet de véritablement démocratiser un régime politique.
Il est invraisemblable qu’un professeur au Collège de France puisse écrire un pareil tas d’âneries. Dans sa conclusion, il annonce travailler aux solutions à apporter à la « crise de la représentation ». À 72 ans, nous lui suggèrerions plutôt que le temps est venu de prendre une retraite bien méritée, et de laisser les recherches sur la démocratie et les périls qui la menacent à d’autres.
À éviter : Pierre Rosanvallon, Le siècle du populisme, histoire, théorie, critique, Paris, Le Seuil, 2020.
[1] Moritz Rittinghausen devient tout à coup « Carl » Rittinghausen (p. 123), renommé « Maurice » dans l’index, le sociologue fonctionnaliste Gino Germani, spécialiste du péronisme, est décrit comme un « marxiste » (p. 143), la Critique du droit politique hégélien de Marx aurait été écrite en 1842 (et non en 1843, p. 163), l’assemblée athénienne (l’ecclèsia) devient l’Agora (p. 187), les town-meetings de la Nouvelle Angleterre des townships (p. 200), William Jennings Bryan, candidat démocrate aux élections présidentielles américaines de 1896, 1900 et 1908, devient « James Bryan » (p. 261), pour ne mentionner que quelques-unes des erreurs factuelles qui émaillent ses pages. La meilleure reste tout de même la confusion entre la Déclaration d’Indépendance de 1776 et la Constitution des États-Unis de 1787 (p. 27), qui à elle seule suffirait à mettre en doute le sérieux de l’ouvrage…
[2] Qu’il n’ait rien lu sur les référendums semble assez clair à la lecture de son chapitre, mais il a en revanche entendu plusieurs spécialistes lui en parler lors d’un séminaire au Collège de France qu’il avait lui-même organisé – notamment le regretté Andreas Auer, ou Laurence Morel, spécialiste du référendum en France et qui vient de publier un petit livre sur la question (Laurence Morel, La question du référendum, Paris, Presses de Sciences Po, 2019) –, pendant lequel il ne semblait pourtant pas dormir (mais peut-être son âge fait qu’il ne s’en souvienne plus très bien, ce qui n’est pas à exclure).