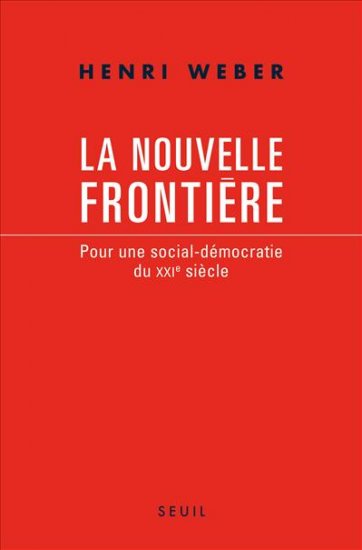Le dernier livre d’Henri Weber est décevant à plus d’un titre. Il l’est tout d’abord parce que son style hésite sans cesse entre le manifeste de campagne (on prépare la présidentielle de 2012 depuis de nombreux mois chez les socialistes français) et la réflexion dégagée de toute échéance électorale. Il l’est ensuite parce que les éléments de réflexion qui s’y trouvent sont assez largement indigents, surtout si on les compare rapidement à ce que certains auteurs se réclamant du socialisme ont produit depuis la crise de 2008[1]. Il l’est enfin par certains dérapages politiques et confusions idéologiques dont l’auteur se rend coupable au fil de ses quelque 200 pages. Rapide tour d’horizon d’un ouvrage qui en définitive vaut davantage pour le témoignage qu’il nous donne de l’état politique du PS français que par ses propositions concrètes.
Le dernier livre d’Henri Weber est décevant à plus d’un titre. Il l’est tout d’abord parce que son style hésite sans cesse entre le manifeste de campagne (on prépare la présidentielle de 2012 depuis de nombreux mois chez les socialistes français) et la réflexion dégagée de toute échéance électorale. Il l’est ensuite parce que les éléments de réflexion qui s’y trouvent sont assez largement indigents, surtout si on les compare rapidement à ce que certains auteurs se réclamant du socialisme ont produit depuis la crise de 2008[1]. Il l’est enfin par certains dérapages politiques et confusions idéologiques dont l’auteur se rend coupable au fil de ses quelque 200 pages. Rapide tour d’horizon d’un ouvrage qui en définitive vaut davantage pour le témoignage qu’il nous donne de l’état politique du PS français que par ses propositions concrètes.
Contrairement à Tony Judt que je mentionnais à l’instant, Henri Weber ne commet pas l’erreur de magnifier outrancièrement les « trente glorieuses ». Il rappelle à plusieurs reprises que le compromis social-démocrate de ce temps, compromis « offensif » précise-t-il bien, n’est plus possible aujourd’hui. Pour ne pas s’enfermer dans une variante ou une autre des différents « compromis défensifs » élaborés par les gauches européennes depuis trente ans, Henri Weber en appelle donc à une « troisième refondation » de la social-démocratie, construite autour d’un nouvel internationalisme, d’un projet européen, d’une visée éco-socialiste et d’une transformation des structures du parti socialiste.
Le premier problème est que l’internationalisme prôné par Weber est, par un monstrueux contresens, ramené à une variante plus ou moins philanthropique de la mondialisation, une « mondialisation humaniste » (p. 148), comme il l’écrit, où l’OMC serait renforcée et les grandes organisations internationales rempliraient enfin leur rôle régulateur apaisant. Nous défendons, nous, un internationalisme qui ne cherche pas à dénoncer « l’angélisme des pères fondateurs » (p. 148), mais à rappeler que les travailleuses et les travailleurs, les employé·e·s et les salarié·e·s ont les mêmes intérêts dans tous les pays du monde, et qu’ils sont en lutte contre les mêmes adversaires partout, à savoir les patron·ne·s et les actionnaires, ceux que naguère on pouvait encore appeler les capitalistes. Weber semble avoir oublié ses fondamentaux, tant pis pour lui.
Ses propositions sur l’Europe sont désespérantes tant elles manquent d’ambition. Si l’on veut rester fidèle au projet européen tout en ne légitimant pas la grotesque parodie qu’il est devenu sous la férule des Barroso, Trichet et consorts, il y faudrait plus de vision ! On pourrait par exemple rappeler le discours de Joschka Fischer à l’Université Humboldt en 2000, lorsqu’il a proposé que la France et l’Allemagne forment le noyau d’une véritable fédération européenne. Aujourd’hui, à défaut d’un grand dessein de plus en plus improbable politiquement, il faudrait au minimum réviser complètement les statuts de la BCE, harmoniser les politiques fiscales, pousser la Grande-Bretagne vers la sortie et, bien sûr, annuler le traité de Lisbonne et toutes les catastrophes économiques et commerciales qu’il porte en lui[2]. On est loin du compte dans La nouvelle frontière, malheureusement.
L’éco-socialisme à la sauce Weber, quant à lui, n’est qu’un triste industrialisme vert, fasciné par les solutions technologiques et par les mécanismes de marché censés lutter contre le réchauffement climatique, incapable de remettre vraiment en cause l’industrie électro-nucléaire, et visiblement grand amateur de fiscalité écologique[3]. Un peu plus et il était nommé par Sarkozy coordinateur de cette grande farce de « Grenelle de l’environnement »… Quant à la transformation du parti socialiste, si l’on peut savoir gré à Henri Weber de rappeler l’importance d’un parti de militant·e·s à gauche, le paternalisme avec lequel il le conçoit est inquiétant. Qu’on en juge : « les partis socialistes doivent être des porteurs d’intelligibilité, des éclaireurs de l’avenir ». Diantre ! « Les citoyens qu’ils représentent ont besoin de comprendre la société dans laquelle ils vivent, ses enjeux, ses acteurs, ses conflits, ses devenirs possibles, son avenir souhaitable » (p. 209). Est-ce effectivement un parti qui a porté aux nues durant de nombreux mois un multimillionnaire, directeur du FMI de son état, et s’apprêtait à le présenter à l’élection présidentielle, qui va être capable de faire comprendre la société dans laquelle ils vivent à des électrices et électeurs de gauche qui gagnent entre 1000 et 1500 euros par mois (la moitié des travailleuses·eurs français) ? J’ai la faiblesse de penser que ce seraient plutôt ces derniers qui auraient beaucoup à apprendre à des dirigeant·e·s du PS totalement coupés de la réalité économique et sociale de leur pays.
Le constat qui ouvre le livre n’est pas d’un meilleur tonneau. Il reprend bien des antiennes conservatrices, sur le « coût » du travail[4] ou sur l’âge de la retraite que, décidément, on ne peut pas maintenir au même niveau dans une société qui vieillit[5]. Weber dérape même complètement lorsqu’il dénonce « l’explosion des incivilités et des délits » (p. 45) (à moins qu’il ne parle des patron·ne·s du CAC 40, mais il est malheureusement permis d’en douter), souhaite que les gouvernements de gauche assurent « la tranquillité publique » (p. 46), et écrit que « l’afflux des immigrés et la difficulté conjointe d’assimiler une partie de leurs enfants […] nourrissent des réactions national-populistes » (p. 49). Avec de pareilles positions, Weber se retrouve soudain, et de manière quand même assez surprenante compte tenu de son parcours, à l’extrême droite du PS.
J’annonçais au début que le livre hésite sans cesse entre le pamphlet électoral et la réflexion politique. Il faut maintenant ajouter qu’il fait mal l’un et l’autre, en proposant un projet mou, à peine réformiste et sans ambition, et en répétant quelques idées reçues sur le « nouveau monde » dans lequel nous vivrions. Pauvre social-démocratie, qui doit se contenter de tels manifestes…
[1] Ne serait-ce que David McNally (Global Slump, Oakland, PM Press, 2011) ou Tony Judt (Contre le vide moral, 2011), chroniqué ici même par Romain Felli et qui, malgré ses insuffisances, a au moins le mérite d’apporter un peu de matière et de profondeur historique à sa démonstration. Il est vrai que Judt ne pouvait plus prétendre à un quelconque poste ministériel… Dans un autre registre, on pense aussi à Paul Krugman, L’Amérique que nous voulons (2008) ou à Emmanuel Todd, Après la démocratie (Paris, Gallimard, 2008).
[2] Et peut-être ajouter, comme l’a fait ce même Joschka Fischer l’an passé, que l’UE ne survivra sans doute pas à une réélection de Sarkozy et de Merkel, mais c’est une autre histoire.
[3] Et, devrais-je ajouter, lecteur de ce vieux réactionnaire de Hans Jonas (comme on peut le voir en page 184, où Weber cite élogieusement le Principe responsabilité qu’il n’a manifestement pas lu, ou du moins en est-on réduit à l’espérer).
[4] Quelqu’un devra semble-t-il expliquer à Henri Weber que le travail a, si l’on veut, un prix, mais qu’il n’a pas de coût. Ce qui a un coût, ce sont les profits faits sur le travail, pas le travail lui-même, évidemment ! Parler de « coût » du travail, c’est ipso facto donner raison à l’idéologie de droite qui considère que toute assurance sociale est inutile et improductive. Ici comme ailleurs, la droite ne montre, par cet argument, que son abyssale impéritie économique.
[5] Sur ce point, voir Pages de gauche n° 90 (août 2010), p. 8, la chronique des livres de Bernard Friot et Gérard Filoche.
—-
Henri WEBER, La nouvelle frontière, pour une social-démocratie du xxie siècle
Paris, Le Seuil, 2011, 226 p.